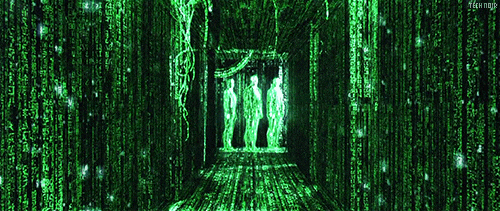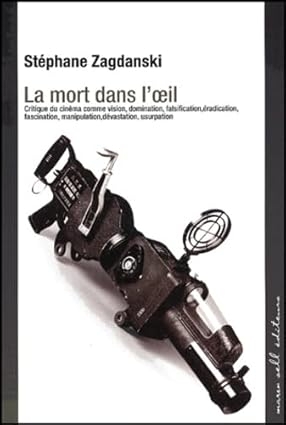
« Quand on aime le cinéma, on n’aime pas la vie » disait François Truffaut qui aimait les femmes et le cinéma, ou plus exactement les femmes au cinéma. « Quand on aime le cinéma, on consomme de la mort » écrit Stéphane Zagdanski dans La Mort dans l’œil, assurément l’essai le plus iconoclaste de l’année 2004 et qui aura décimer plus d’un amateur de salles obscures. Epaulé par Baudelaire, Kafka, Proust, Céline, Claudel, Heidegger qui lui servent de rabatteurs, et de l’inévitable Guy Debord, le chien d’arrêt de tous les penseurs spectaculaires de l’anti-spectacle, la chasse du comte Zagdanski peut commencer
Voilà un livre qui ne fait pas de quartier. Pour qui Murnau, Fellini ou Cassavetes comptent autant que Molière, Stendhal ou Nietzsche, difficile en effet de s’entendre dire à tout bout de champ que la cinéphilie est une « Schlague », qu’ « aimer les films intellectuels est un plaisir de pédophile », que le cinéma, cette « glue hypnotique » qui a perverti le goût, n’a jamais existé en tant qu’art, et qu’il ne faut d’ailleurs rien comprendre à l’art pour croire que « cette trouvaille de foire » en est un.
Evidemment, ça va pleurer dans les salles de rédaction des Cahiers du cinéma et des Inrockuptibles. Ce n’est pas tous les jours que l’on traite Eisenstein comme Walt Disney, que l’on met Godard au niveau de Spielberg, et même au dessous, car « Godard est même plus probablement un peu plus imbécile que Spielberg [car] il l’ignore qu’il l’est. », que l’on compare le Rashomon de Kurosawa à un James Bond, et que l’on dit que son plan préféré dans l’histoire du cinéma est celui, « dionysiaque » à souhait, de Michael Jordan bondissant sur Bugs Bunny dans Spacejam.
Sans compter l’accusation de fascisme, inhérente au cinéma depuis ses débuts*, mais qui, sous la plume de Zagdanski, (guy-)déborde tout ce qui se dit d’habitude entre citoyens vigilants. Nulle différence, à ses yeux, entre le cinéma de propagande et le cinéma qui dénonce la propagande. Quoiqu’elle fasse, l’image, qui n’est qu’une copie des choses, est incapable de dire le vrai ou de subvertir le faux. Chaplin a beau faire, son Dictateur se confond avec Hitler du fait même qu’il mime Hitler. Idem avec Godard dont on ne sait jamais dans ses Histoires du cinéma s’il condamne ou approuve le nazisme. Quand il tente de traiter l’histoire, tout cinéaste, du plus probe au plus racoleur, se retrouve révisionniste malgré lui. Au cinéma, résister, c’est collaborer. Bref, qu’on soit devant Amélie Poulain ou un film des Straub, on est toujours devant du fascisant. Rien que pour imaginer la tête de Kaganski le lisant, le livre de Zagdanski vaut le coup.
Hélas ! contrarier les vigiles de la culture ne suffit pas. Pour autant qu’il soit drôle et hygiénique, le propos de Zagdanski n’en est pas moins tellement radical qu’on se demande à la fin si cette manière de ne voir dans le cinéma qu’une mise à mort de la pensée par la vue n’est pas ajouter de l’eau aux moulins des fascismes imaginaires, et par là-même se retrouver super vigile. C’est l’impression que donne ce livre : partir du culturellement incorrect le plus audacieux - c’est vrai, le cinéma, comme le gaullisme, est « une cause victorieuse » à laquelle on ne s’attaque jamais, c’est vrai, la cinéphilie est un cancer culturel qui fait de l’image une pensée et du générique un savoir, c’est vrai, Orson Welles est un imposteur qui participe à l’idolâtrie ambiante tout en feignant de la critiquer - et tomber dans le politiquement correct le plus affligeant : le cinéma, qui ne nous dit rien et nous cache tout, n’est qu’un programme capitalistotalitaire qui nous surveille de près, nous régit de loin, nous insinue son néant, nous prépare au clonage généralisé, bref se révèle une matrice effrayante et mortifère à laquelle même le film Matrix participe.